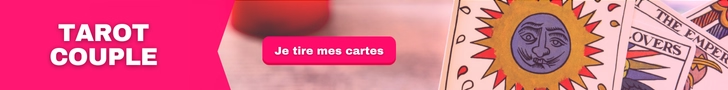Deux fois par an, nous ajustons nos horloges dans un rituel devenu automatique : le changement d’heure. Cette pratique, née d’une volonté d’économiser l’énergie, trouve ses racines dans une idée vieille de plus de deux siècles et s’est imposée progressivement à travers l’Europe pour des raisons à la fois historiques, économiques et géopolitiques.
L’origine historique du changement d’heure
Benjamin Franklin et la première idée d’économie d’énergie
L’histoire du changement d’heure commence bien avant son application moderne. En 1784, Benjamin Franklin évoque pour la première fois dans le quotidien français Le Journal de Paris la possibilité de décaler les horaires afin d’économiser l’énergie. Cette proposition, initialement présentée sous forme de canular, visait à économiser les bougies et chandelles en profitant davantage de la lumière naturelle.
À cette époque, la société française était encore largement agricole et l’heure “utile” restait celle du Soleil, qui variait de 50 minutes de l’est à l’ouest de la France. L’idée de Franklin, bien qu’innovante, ne trouvera pas d’application immédiate dans une société où les rythmes de vie suivaient encore les cycles naturels.
L’unification de l’heure nationale en France
Un siècle plus tard, le développement des transports ferroviaires va nécessiter une unification de l’heure sur l’ensemble du territoire français. La création quasi simultanée du télégraphe électrique renforce cette nécessité de synchronisation.
En 1891, une décision majeure est prise : l’heure de Paris devient l’heure nationale. Cette standardisation s’inscrit dans un mouvement mondial où chaque pays adopte progressivement une heure unifiée basée sur son méridien de référence.

La mise en pratique pendant la Première Guerre mondiale
C’est pendant la Première Guerre mondiale que l’idée de Franklin trouve enfin sa concrétisation. L’Allemagne devient pionnière en instaurant le premier changement d’heure le 30 avril 1916. Cette initiative répond à un besoin urgent d’économiser les ressources énergétiques en temps de guerre. Le Royaume-Uni suit rapidement cette initiative le 21 mai 1916 en mettant en place le British Standard Time.
En France, l’introduction d’une heure d’été est proposée en 1916, votée en 1917, devançant de peu les États-Unis qui adoptent le changement d’heure en 1918. Cette synchronisation européenne marque le début d’une pratique qui s’étendra progressivement à l’ensemble du continent.
L’évolution du changement d’heure en France
Les premières applications et ajustements
Après la guerre, la France expérimente différentes formules. En 1940, sous l’occupation allemande, le pays adopte l’heure de Berlin, nécessitant d’ajouter deux heures en été sur l’heure de Greenwich et une heure en hiver. En 1945, la France revient à l’heure de 1916, en appliquant l’heure d’été pendant toute l’année.
Cette période d’expérimentation montre combien les considérations géopolitiques influencent les choix horaires. L’alignement sur l’heure allemande pendant l’occupation illustre parfaitement comment le changement d’heure peut devenir un enjeu de souveraineté nationale.
Le choc pétrolier de 1973 et la généralisation
Le véritable tournant survient avec le choc pétrolier de 1973-1974. L’envolée des prix du pétrole, multiplié par quatre, fait exploser le coût de l’électricité produite principalement au fioul. Face à cette crise énergétique majeure, le président Valéry Giscard d’Estaing prend une décision historique en 1975.
Le décret du 19 septembre 1975 introduit officiellement une heure d’été en France hexagonale. Cette mesure vise à économiser l’énergie en réduisant les temps d’éclairage grâce à une heure d’ensoleillement naturel supplémentaire le soir. Depuis 1976, la France applique donc ce système : les montres sont avancées l’hiver d’une heure sur l’heure de Greenwich et de deux heures pendant l’été.

L’harmonisation européenne du changement d’heure
La coordination progressive des pays européens
L’instauration de l’heure d’été dans tous les pays européens entraîne initialement des complications importantes dans les télécommunications internationales et les transports. Pour résoudre ces problèmes de coordination, l’Union européenne décide d’harmoniser progressivement cette pratique.
Le changement d’heure estival est introduit dans l’ensemble des pays de l’Union européenne au début des années 1980. Cette harmonisation répond à une nécessité pratique : maintenir la synchronisation avec les pays limitrophes qui changent d’heure.
La standardisation actuelle
Depuis 2002, le changement d’heure s’opère de façon homogène dans tous les États membres de l’Union européenne :
- Le passage à l’heure d’été s’effectue dans la nuit du dernier samedi au dimanche du mois de mars.
- Le passage à l’heure d’hiver s’effectue dans la nuit du dernier samedi au dimanche du mois d’octobre.
Cette harmonisation concerne les trois fuseaux horaires européens : Europe occidentale (UTC), Europe centrale (UTC+1) incluant la France, et Europe orientale (UTC+2).
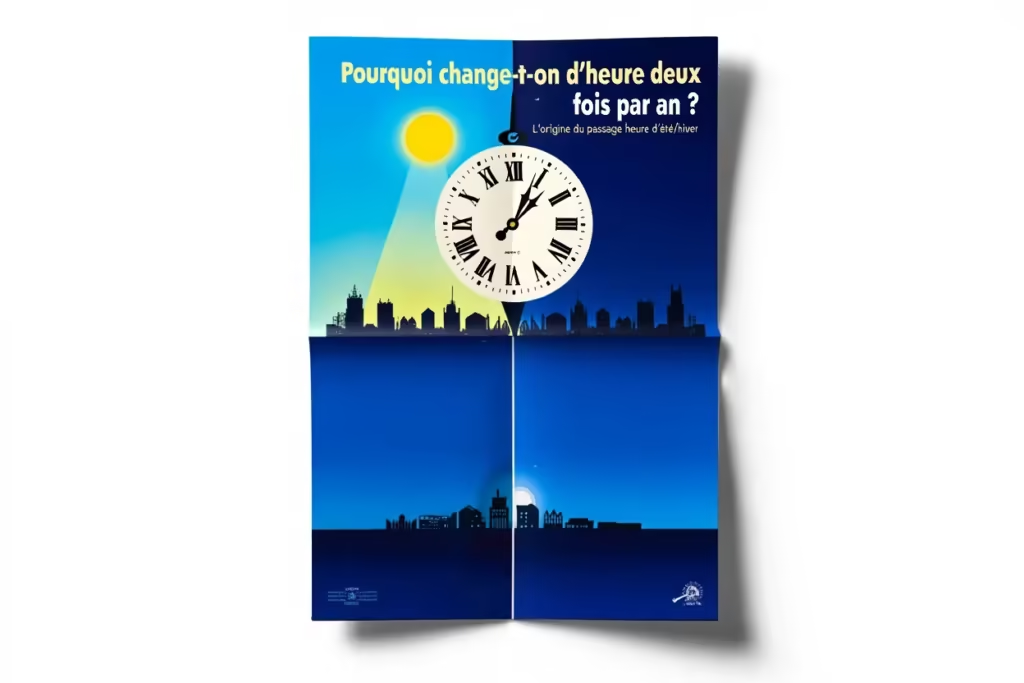
Les mécanismes pratiques du changement d’heure
Comment fonctionne le passage à l’heure d’été ?
Lors du passage à l’heure d’été, les horloges sont avancées de soixante minutes, généralement entre minuit et 4 heures selon les pays. Dans la pratique française, ce changement s’opère à 2 heures du matin qui devient instantanément 3 heures. Cette manipulation temporelle fait qu’il est couramment dit qu’“une heure de sommeil est perdue”.
Pour les lève-tôt comme moi, ce passage représente toujours un petit défi d’adaptation. Je me souviens particulièrement d’un dimanche matin où, ayant oublié le changement d’heure, j’ai cru être en retard d’une heure pour un rendez-vous important !
Le retour à l’heure d’hiver
Inversement, lorsqu’on repasse à l’heure normale en octobre, les horloges sont retardées de soixante minutes et “une heure de sommeil est gagnée”. Ce passage s’effectue à 3 heures du matin qui redevient 2 heures, offrant cette précieuse heure supplémentaire de repos.
La responsabilité de ces modifications horaires relève en France de l’Observatoire de Paris, qui est en charge d’établir, de maintenir et de diffuser le temps légal français.

Les objectifs et bénéfices du changement d’heure
L’économie d’énergie : objectif principal
L’objectif principal du changement d’heure reste la réduction de la consommation énergétique. En utilisant davantage la lumière naturelle, nous réduisons théoriquement notre consommation d’électricité pour l’éclairage. Cette économie s’avère particulièrement pertinente le soir, lorsque les activités domestiques et professionnelles nécessitent un éclairage artificiel.
Une étude conduite par le Service de recherche du Parlement européen nuance cependant l’ampleur de ces économies. Selon ces travaux, le “changement d’heure a très clairement un effet sur la consommation d’énergie”, mais l’économie réalisée varie entre 0,5 % et 2,5 % de la consommation totale selon les pays. La latitude expliquerait en grande partie ces différences, les pays du sud du continent bénéficiant davantage de ces mesures.
Les avantages secondaires
Au-delà des économies d’énergie, le changement d’heure présente d’autres avantages. Les longues soirées d’été favorisent les activités extérieures et le bien-être général. Personnellement, j’apprécie particulièrement ces soirées prolongées qui permettent de profiter du jardin ou de faire du sport après le travail.
Certaines études mentionnent également que le changement d’heure faciliterait les activités à l’extérieur, contribuant ainsi à une meilleure qualité de vie pendant la période estivale.

Les inconvénients et critiques du système
Les impacts sur la santé
Malgré ses avantages, le changement d’heure suscite de nombreuses critiques. Une synthèse du Parlement européen souligne que l’effet sur la santé n’est globalement pas clair. Certaines études considèrent que les effets négatifs sur les rythmes biologiques ont été sous-estimés.
Les troubles du sommeil constituent l’un des principaux reproches adressés au système. Le décalage horaire artificiel perturbe notre horloge biologique interne, provoquant fatigue, irritabilité et difficultés de concentration pendant plusieurs jours après chaque changement.
Les conséquences sur la sécurité routière
L’heure d’été a également une influence notable sur la sécurité routière. Des études montrent un risque accru d’accidents de la route au cours des deux premiers jours suivant le changement de printemps [1]. Après le changement d’automne, les accidents mortels augmentent pendant une courte période, les jeunes conducteurs étant particulièrement touchés.
L’impact sur l’agriculture et les animaux
Le secteur agricole subit également les conséquences du changement d’heure. Les animaux domestiques, notamment les vaches laitières, sont profondément perturbés par la modification des horaires de traite. Cette perturbation entraîne systématiquement une baisse de production de lait et génère du stress qui altère la qualité du produit.
Un rapport remis au Sénat français en 1997 [2] concluait d’ailleurs que “les avantages annoncés ou attendus du changement semestriel de l’heure ne sont pas suffisamment importants pour compenser les inconvénients ressentis par les populations”.

Le débat sur l’abolition du changement d’heure
L’initiative européenne de 2018
En 2018, l’Union européenne lance une consultation publique qui révèle que les Européens sont favorables à l’abandon du changement d’heure deux fois par an. Cette consultation, précédée par des études montrant depuis 2014 l’opposition croissante des citoyens, débouche sur un vote du Parlement européen.
En mars 2019, les eurodéputés votent effectivement pour la suppression du changement d’heure saisonnier, avec une mise en application initialement prévue pour 2021. Cette décision historique semblait marquer la fin d’une pratique centenaire.
L’ajournement et les obstacles
Cependant, la fin du changement d’heure a été ajournée en raison notamment de la crise sanitaire de la Covid-19. Les complications liées à la pandémie, les priorités politiques modifiées et les difficultés de coordination entre États membres ont relégué ce dossier au second plan.
Aujourd’hui, ce texte sur la fin du changement d’heure n’est plus à l’ordre du jour. La proposition de revenir sur le changement d’heure, après avoir suscité beaucoup d’enthousiasme au niveau européen, semble désormais dans l’impasse.
Les enjeux techniques et géopolitiques
La complexité de la coordination internationale
L’abandon du changement d’heure soulève des questions techniques complexes. Chaque pays devrait choisir entre maintenir l’heure d’été ou l’heure d’hiver de façon permanente. Cette décision pourrait créer des décalages horaires inédits entre pays voisins, compliquant les échanges commerciaux et les communications.
La France, située dans le fuseau Europe centrale (UTC+1) avec l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne et l’Italie notamment, devrait coordonner sa décision avec ses principaux partenaires européens pour éviter les dysfonctionnements.
L’influence des considérations économiques
Les secteurs économiques concernés par les horaires, notamment les transports, l’énergie et les télécommunications, exercent également des pressions contradictoires. Certains plaident pour le maintien du système actuel par habitude, d’autres pour sa suppression au nom de la simplification.
L’avenir du changement d’heure
Les tendances actuelles
Malgré l’ajournement de la réforme européenne, le débat sur le changement d’heure reste d’actualité. Les arguments en faveur de sa suppression s’accumulent : impacts négatifs sur la santé, économies d’énergie discutables, complications logistiques.
Certains pays européens continuent de faire pression pour relancer le dossier. La Finlande, par exemple, milite activement pour l’abandon de cette pratique qu’elle juge obsolète et néfaste pour ses citoyens.
Les alternatives envisagées
Plusieurs scénarios sont envisagés pour l’avenir. Le maintien permanent de l’heure d’été séduirait ceux qui privilégient les longues soirées estivales. Inversement, l’adoption définitive de l’heure d’hiver correspondrait mieux aux rythmes biologiques naturels.
Une troisième option consisterait à laisser chaque pays libre de son choix, au risque de créer une mosaïque horaire complexe en Europe. Cette solution pragmatique pourrait satisfaire les spécificités nationales tout en compliquant les relations internationales.
Conclusion
Le changement d’heure, né d’une idée de Benjamin Franklin en 1784 et concrétisé pendant la Première Guerre mondiale, illustre parfaitement comment une mesure d’urgence peut devenir une habitude séculaire. Instauré en France en 1976 suite au choc pétrolier, harmonisé au niveau européen depuis 2002, ce système continue de rythmer nos vies malgré les controverses croissantes.
Aujourd’hui, alors que les économies d’énergie réalisées semblent marginales et que les inconvénients sanitaires et sociaux s’accumulent, l’avenir du changement d’heure reste incertain. Entre tradition et modernité, entre coordination européenne et souveraineté nationale, ce débat révèle les complexités de nos sociétés contemporaines.
Que nous gardions ou abandonnions cette pratique, une chose est certaine : le changement d’heure aura marqué plus d’un siècle de notre histoire commune, témoignant de notre capacité collective à adapter nos rythmes de vie aux défis énergétiques et géopolitiques de chaque époque.
Sources :
[1] Neumann, P., & von Blanckenburg, K. (2025). What Time Will It Be? A Comprehensive Literature Review on Daylight Saving Time. Time & Society, 0(0). https://doi.org/10.1177/0961463X241310562
[2] Faut-il en finir avec l’heure d’été ? – Rapports d’information du Sénat.